LA PRESENCE MILITAIRE ETRANGERE EN AFRIQUE : STABILISATION OU NEOCOLONIALISME DEGUISE ?
POLYCARPE OKOLONGO
Depuis la période des indépendances africaines, la présence militaire étrangère en Afrique constitue une réalité persistante. Elle est officiellement justifiée par des objectifs de stabilisation, de lutte contre le terrorisme ou d’appui des États en difficulté ; cependant , elle suscite une vive controverse. Pour bon nombre de chercheurs, mais également pour des militants panafricanistes ou des citoyen(ne)s, elle évoque plutôt une modalité contemporaine de domination, un « néocolonialisme sécuritaire » reconduisant des rapports inégaux qui caractérisaient la colonisation.
La multiplication des bases militaires étrangères (françaises, américaines, turques, russes...) nourrit le débat autour de ce qui pourrait être un partenariat sécuritaire bénéfique ou, au contraire, un moyen de contrôle indirect des puissances étrangères sur les États africains. Cet article se propose d’examiner cette dynamique à l’aune d’une complexité que l’on pourrait envisager sous deux angles : celui de la stabilisation sécuritaire d’une part, et celui de la dépendance stratégique voire de l’ingérence déguisée, d’autre part.
I. Une présence militaire étrangère sous prétexte de stabilisation
Faisant face à des menaces internes, un certain nombre d’États africains sont confrontés à des insurrections armées, à des groupes terroristes, à des conflits interethniques ou au trafic transnational. Étant donné l’incapacité dans certains cas des armées nationales à contenir ces crises, plusieurs pays sollicitent des forces étrangères pour restaurer un semblant de stabilité. Pendant longtemps en ont témoigné les bases militaires, en Côte d’Ivoire, au Tchad et plus généralement dans la zone sahélienne.
La France fut longtemps présente au Tchad, au Gabon, en Côte d’Ivoire, et au Niger sur la base d’une défense de la souveraineté des États partenaires comme fondements de sa présence. Les États - Unis, par le biais du commandement des États - Unis pour l’Afrique (AFRICOM), se consacrent également à des opérations de renseignement et de lutte contre le terrorisme en Afrique de l’Est et de l’Ouest. Parallèlement à cela, d’autres acteurs comme la Turquie et les Émirats arabes unis installent peu à peu des infrastructures militaires en Afrique orientale, au Soudan et en Somalie, notamment. Certaines autorités africaines présentent ces alliances comme des gages de sécurité et de développement . Mais cette stabilisation reste souvent superficielle, éphémère, sans véritable solution structurelle aux causes profondes des conflits.
II. Des intérêts géostratégiques et économiques masqués
Au - delà de la stabilité, plusieurs chercheurs évoquent une dimension plus cynique des motivations géopolitiques. La présence militaire étrangère correspond le plus souvent à une protection de zones stratégiques riches en ressources naturelles ou à des zones ayant un intérêt logistique ou énergétique déterminant (pétrole, uranium, terres rares, routes commerciales).
Dans le Sahel, l’uranium nigérien joue un rôle clé dans l’approvisionnement de l’industrie nucléaire française ; dans le Golfe de Guinée, l’activité de plusieurs acteurs se concentre sur les ressources pétrolières. La position militaire dans ces zones permet aux puissances extérieures de sécuriser les approvisionnements et d’asseoir leur pouvoir dans la région. En outre, la présence militaire instaurée crée un déséquilibre international, en rendant les États africains plus dépendants des puissances tierces. Loin d’être principalement motivées par les considérations de souveraineté du continent noir, les prises de décision en matière de stratégie militaire se font également selon les critères relevant des intérêts sécuritaires et économiques des puissances extérieures.
La logique d’assistance sécuritaire permanente empêche de construire une véritable souveraineté militaire dans nombre de pays africains. L’effort en direction de la formation, de la recherche stratégique et du renforcement du cadre institutionnel de défense est marginal car les solutions considérées par les élites politiques restent largement courtermistes, souvent fondées sur des logiques d’allégeance ou de survie politique. La dépendance sécuritaire nuit également aux relations entre militaires et populations. Quand l’État exporte sa sécurité vers d’autres instances extérieures, il diminue de plus en plus sa légitimité auprès de sa population. Cela alimente notamment la méfiance, voire la radicalisation des jeunes générations. D’où des voix s’élèvent pour réclamer la souveraineté sécuritaire africaine, qui devrait être portée par une mise en œuvre cohérente des politiques publiques à travers une armée professionnelle et des partenariats équilibrés. L’Union africaine tente déjà d’instaurer une architecture continentale de sécurité, mais elle s’avère encore faible face aux influences extérieures et à l’absence de financement autonome.
En conclusion , la présence militaire étrangère en Afrique demeure une question délicate et complexe. Si elle remédie parfois à des urgences sécuritaires, elle entretient surtout une certaine dépendance politique et stratégique, difficilement compatible avec le souci d’autodétermination des peuples africains. Pour sortir de cette logique néocoloniale, les États africains doivent asseoir leurs propres capacités sécuritaires , édifier des institutions solides, et promouvoir une diplomatie continentale solide, négociant d’égal à égal avec l’ensemble des puissances. La stabilisation véritable ne peut venir que d’une refonte de l’État de droit, d’une armée professionnelle et d’un contrat social refondé entre gouvernants et gouvernés. Toute autre approche n’aboutira qu’à prolonger indéfiniment une souveraineté à tout jamais inachevée, toujours maintenue sous le mirage d’une sécurité importée.

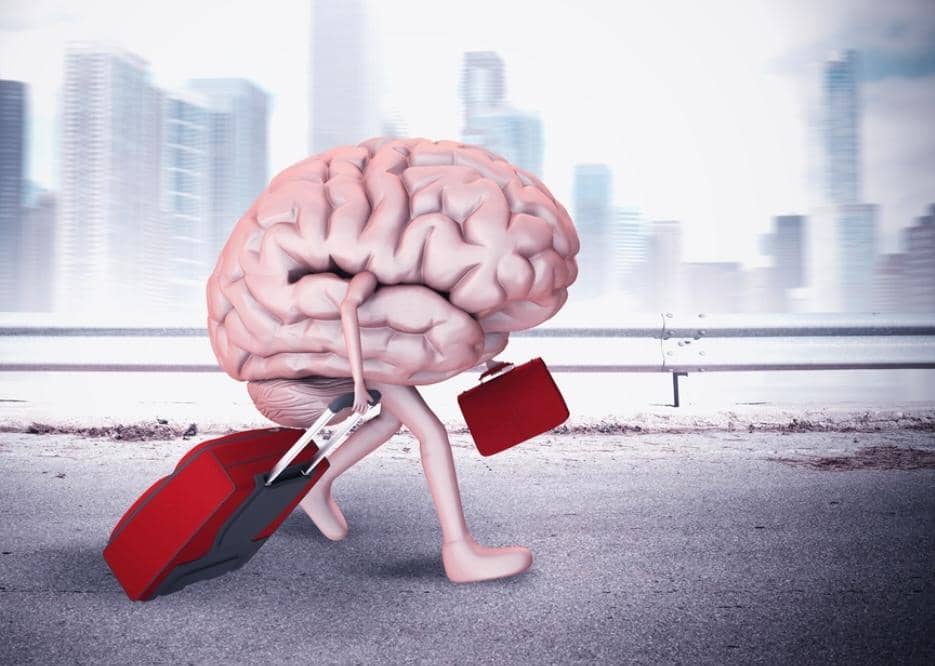

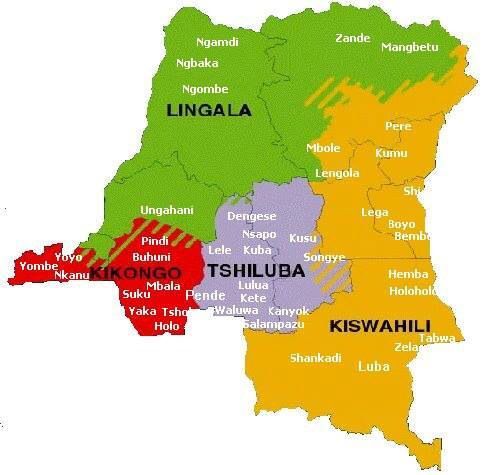

Comments (0)
No comments yet. Be the first to share your thoughts!